L’ironie du destin est parfois mordante: aujourd’hui, juste avant l’entrée en vigueur du second jet de confinement, les éditions Grasset et Fasquelle publient une réédition de Raboliot de Maurice Genevoix: pour cause, l’écrivain entre au Panthéon. Ce roman dans la prestigieuse collection des « Cahiers Rouges » est l’un des plus connus d’un écrivain de génie que l’on a souvent réduit à la guerre qu’il avait menée, ou à la Sologne qu’il aimait. Pourtant, au delà du prix Goncourt et de ses écrits de Poilu, Genevoix est un conteur magnifique au vocable fin.

Ce bon livre de campagne est un tour de plaine salutaire à ceux qui vont se cloîtrer: il montre la poursuite effrénée entre le gendarme Bourrel et le braconnier Fouques, dit Raboliot.
Relire Raboliot en confinement est un exercice de funambule, qui attise l’envie de l’extérieur autant qu’il la soigne : car ce grand récit de Sologne est une invitation à filer en trottant le long des sentiers nocturnes. Passé les premières semaines d’hébétudes, nous pourrions aussi vivre le confinement comme l’occasion réjouissante, et probablement trop rare, de nous (re)plonger dans des chefs d’œuvres restés trop longtemps sur l’étagère avec un œil intimidant. La Guerre et la Paix ou Anna Karénine, Cent ans de solitude, Les Misérables, la liste est vertigineuse et agit en intra-veineuse comme une cure sans égal.
Ce n’est pas une émotion de lecture si différente de celle des récits de Victor Hugo, que je retrouve en lisant à nouveau ce roman. Il y a un timbre, une allure de la « noirté du noir » et d’ailleurs une expression du peuple qui rappelle Les Misérables. Des personnages comme Sandrine, Souris, la Flora, et bien sûr Bourrel / Raboliot font ressurgir dans ma mémoire à l’époque adolescente les émois de Javert / Jean Valjean, Cosette, Fauchelevent et Fantine. Comment ne pas penser à Javert qui traque l’ancien bagnard, lorsque Bourrel s’obstine sous son képi détrempé à poursuivre le braconnier ?
Mais la plus différente des formes aspirantes du texte par rapport à Hugo, c’est qu’il s’agit moins d’un conte populaire urbain que de l’expression de la campagne en 1925, avec une langue maîtrisée jusqu’aux abysses de l’idiome, du dialecte, jusqu’aux boiseries du dictionnaire.
L’imaginaire que Maurice Genevoix condense est plein de scènes marquantes: celle de troupe à la tablée de Trouchut, celle d’une scène de pêche avec Volat, ou l’astuce du récit des gars de Saint-Hubert…Et c’est tout un pays qui se réveille en me montrant que j’assiste à la renaissance de quelque chose que finalement, je vis aussi. J’admire alors ce Raboliot, bien qu’il soit animé par un instinct meurtrier, parce que c’est un homme entier. J’admire ce roman, non pas avec la nostalgie du taxidermiste Touraille mais plutôt comme une toile murale où les huiles, quoiqu’un peu craquelées, n’amenuisent en rien le courage et la précision des âmes que traite la fresque.
Il y a toujours en nous, bien sûr, des passions certaines qui inclinent nos cœurs et menottent notre esprit critique. La mienne est au grand air, à l’évanouissement d’un gibier dans les sous-bois, à la maîtrise de l’encre noire qu’on utilise pour essayer d’emmener quelqu’un avec nous dans les galopades d’un événement qui depuis des nuits nous forge, nous anime, nous arrête au milieu du talus comme un fusain dans l’obscurité. Mais je ne suis pas chasseur, ni braconnier, ni enfant du début du siècle passé. Pourtant, de la même manière qu’un esprit d’adhérence m’illumine soudainement lorsque je suis la lanterne de Hugo (mais sans le faste, les lourdeurs pompeuses), je retrouve aisément chez Genevoix l’épaisseur d’un grand classique, l’émerveillement d’une écriture très juste qui aiguillonne l’inventivité, et l’appui sur l’épaule qui au lieu de m’intimider, me conforte et me pousse. Peut-être est-ce ce qui m’avait d’abord emporté à la lecture des Grands Cerfs de Claudie Hunzinger, malgré l’inégal moment de lecture. Mais chez madame Hunzinger, il n’y avait pas autant ce que je retrouve dans les affûts de Raboliot, c’est à dire l’émotion élémentaire, la description qui condense l’expérience d’un millier de regards, etc. Le texte d’Hunzinger allait trop vite, trop frontalement, sans ménager la fiction, sans brouiller l’effet de réel à celui du conte: autre époque et autres impératifs, autre style surtout.
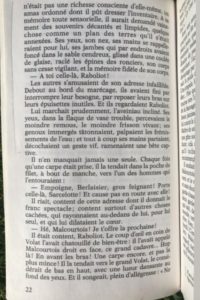
Voilà, il faut relire Raboliot. Au-delà du mythe qu’il a incarné pour la génération de parution, ce n’est pas à mon sens un écologiste ou un révolté. Il est un homme qui ne se préoccupe pas de sa catégorisation: comme Claudel ou Cendrars, lui aussi poilus, il va forger un mythe de Genevoix lui-même. Raboliot est un personnage qui, alors que tous ses sens sont sauvages et pointus, n’entend rien à son propre grelot. Il voit courir la lune trop claire au-dessus de sa perte, mais y investit son succès. Reste que pour contenter la lecture et investir les décombres qui s’amassent sur le corps de son criminel, Genevoix conduit la voix comme un attelage de moisson, superbe et harmonieux, onomastique aussi parfois (Tancogne, Tournerfier… On devine l’influence de Maupassant !). Son vocabulaire est fait d’éteules, de capucines, de « lièves », de russules croquantes et de clayons de genêts. À chaque page du récit, les options favorables à Pierre Fouques « étrécissent », « l’accrassinent » un peu plus, et rendent bachique la discrétion de ses aventures. Une épée de Damoclès est suspendue au-dessus du chasseur désormais chassé, c’est celle de la loi et du devoir incongru, imposé autant par l’orgueil du képi que par la provocation du braco, fier et attaché à sa terre comme un lapin à son collet.

Dans cette narration impliquée — on le sent, de près dans le fretin des petits chasseurs illégaux — je relis chaque fois la preuve d’un grand roman aux caractères de la ruralité, qui ne se dope pas, qui ne gonfle pas son torse pour faire jaillir du patois, du bourru, du faux. Non: Genevoix, c’est la campagne réelle, saisie dans son mouvement ultime : celui qui donne un dernier hommage aux usages pour les faire ployer sous la loi. Il y aurait tant à dire enfin sur l’ironie du cérémonial de la Panthéonisation d’un tel auteur. Si nous aurions pu imaginer que Cendrars, l’auteur après tout de La Main Coupée ou de J’ai tué… rentrer au Panthéon, difficile d’imaginer une compatibilité entre la mythobiographie et le roman national pour ce suisse naturalisé après son service, qui vante souvent les déboires des « Pleins de Soupes », ces officiers qu’il s’amuse en bon légionnaire à moquer et à voler*. De même, Henri Barbusse ou Roland Dorgelès proposent des témoignages marquants, mais n’ont ni le même talent, ni le même engagement politique, ni la même descendance… Toutes ces politiques inutiles risqueraient de nous détourner de la lecture de ce grand animalier qu’est Genevoix, qui a eu une place de choix dans l’histoire éditoriale française et dans le lancement littéraire des Éditions du Seuil. Lisons-le, avant de rentrer dans notre hiver !
Lire aussi: Ceux de 14, La Dernière Harde, Les Éparges, La boite à Pêche, Un Jour, La Maison du Mesnil, etc.
*voir le chapitre « La Grenouillère » dans La Main coupée.